Décidément, cette saison 2024 débute fort sur ce blog en matière de chronique littéraire. Après le recueil de poèmes de Louise Glük, les deux ouvrages de Caroline Bourgine et d’Hector Poullet parus chez CaraïbÉditions (chronique du 7 janvier), voici un petit livre particulièrement revigorant édité à compte d’auteur en novembre 2023 : La porte du ghetto d’Olivier Pies.
De la sociologie à ciel ouvert
Sous-titré en bas de couverture Histoire vraie de mon enfance, ce récit est davantage à mes yeux qu’un simple livre. C’est un document sociologique, j’ose le dire, de la plus haute importance. Mais sans la rigidité académique ni l’ennui généralement soporifique d’un tel ouvrage. L’auteur, sans chercher à faire de la « littérature » par des tournures qui sentent la recherche, nous propose en effet une sorte de conversation avec le lecteur, le prenant souvent à témoin, dans un style alerte, spontané, d’une vivacité surprenante, gage de réalisme et d’authenticité. Récit et conversation truffés de trouvailles originales, passant du burlesque au tragique, qui ne laisseront indifférent aucun lecteur de bonne foi. Bref, Olivier Pies raconte une histoire, comme s’il était sur une scène. Non à la manière d’un comédien interprétant le texte d’un autre, mais comme l’artisan, l’acteur, au sens premier du terme, de son propre vécu. Et c’est le cas dans ce petit ouvrage qui ne paie pas de mine mais qui a son importance pour notre connaissance de l’histoire sociale (sociétale, comme on dit aujourd’hui) pas si lointaine de la Guadeloupe, et que je vous conseille de courir, si ce n’est déjà fait, vous le procurer au plus vite.
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit tout simplement du récit véridique de l’enfance de l’auteur dans le quartier Lacroix-Boissard, non loin de Pointe-à-Pitre, dans la Guadeloupe des années 80. Olivier Pies, surnommé Djono, alors âgé de 12 ans, ne peut se défaire, nous dit la 4è de couverture, « du sentiment de n’être pas à sa place, de n’être pas né au bon endroit. Tout ici le choque et le questionne : les violences conjugales, les coups de feu, les trafics en tout genre, la misère, les descentes de police, l’injustice d’un monde qui parque les pauvres loin du regard des riches. »
« J’ai toujours considéré mon quartier, écrit l’auteur, comme une prison à ciel ouvert. Une sorte de boîte en tôle dont on ne sort que difficilement. Une boîte scellée par trois chaines puissantes : la pauvreté, la violence et la drogue... Je m’y promène comme se promènerait un ours polaire au beau milieu d’une savane africaine. »
Description qui rejoint celle qu’avait faite Ernest Pépin dans son roman policier La Darse rouge (CaraïbÉditions 2018) : qui écrit à la page 77 en parlant de Boissard : « C’était un quartier populaire où les ruelles entortillées, les cases entrelacées, les stigmates de la misère sociale accueillaient tout un peuple de laissés-pour-compte qui se débrouillaient pour survivre en marge de la Guadeloupe officielle… Un quartier où on trouvait des gangs abonnés à toute sorte de trafics et notamment à celui de la drogue… Un quartier où on trouvait en fait les plus démunis, les sans-papiers, les mauvais sujets d’une société en pleine mutation. »
La littérature à l’estomac
Si les descriptions du quartier de Boissard d’Olivier Pies et d’Ernest Pépin se rejoignent par leur réalisme brut, (on devrait surtout dire brutal), et leur caractère historique avéré, il y a néanmoins entre elles une différence de taille.
Celle de Pépin est inscrite dans une fiction et rédigée au passé par un écrivain supposé confortablement installé à son bureau climatisé.
La description d’Olivier Pies est écrite en revanche au présent et s’insère dans le vif, au cœur même de la vie, la vraie. Celle qu’il a vécue, dans une case délabrée, sans eau ni électricité, sans commodités sanitaires, sans souvent de quoi manger, et dont il nous relate les péripéties sordides, sur un ton souvent léger et sans pleurnicherie. Un sujet et une manière d’écrire et de rapporter les faits telle que le préconise Julien Gracq dans un célèbre pamphlet intitulé La littérature à l’estomac (José Corti 1950). Point de vue que partage Jean-Pierre Otte dans La littérature prend le maquis, édition Sens&tonka 2005 : « Si ton écriture va mal, s’empâte ou s’affadit, reste stérile ou mimétique, si l’inspiration te fuit et que le plaisir même se perd, retourne plonger dans la vie la tête la première. »
Plonger dans la vie la tête la première
Plonger la tête la première… dans la misère, on ne peut pas dire qu’Olivier Pies ne l’a pas fait. Il l’a même si bien fait qu’il en a très souvent littéralement touché le fond. Comme le soir où revenant de la plage avec sa mère, son petit frère et sa sœur Olivia, passant devant une roulotte à frites de la Place de la Victoire, il écrit ceci :
« Je ne sais pas si c’est le bain de mer qui nous a ouvert l’appétit et rendus sensibles à ce délicat fumet, mais il semble impossible aux enfants que nous sommes de faire un pas de plus sans une frite en bouche. C’est un véritable supplice de voir tous ces gens quitter la roulotte, leurs frites soigneusement enveloppées dans un cône de papier gris. Encouragé par ma fratrie, je dis à ma mère : « S’il te plaît, achète-nous un cornet de frites, nous avons tous très faim. » Sans me regarder et sans même ralentir sa marche elle répond :
-Si on achète des frites ce soir, on ne pourra pas acheter du pain demain. Alors tu choisis quoi ? »
Je vous laisse le soin de découvrir la suite, pages 37-38 du livre.
La révolte comme premiers pas vers la sortie
Contraint de supporter ces conditions de vie déplorables, pour tout dire inhumaines, voire déshumanisantes, le jeune Olivier ne l’accepte pas pour autant. Il est au contraire révolté très tôt par cette résignation dont font preuve sa mère et les habitants de son quartier. Une résignation qu’il ne comprend pas. « Je sens bien au plus profond de moi, écrit-il, que toutes ces pratiques ne sont pas normales. Je suis sûr qu’une autre façon de vivre est possible, loin de la misère, loin des coups de feu, loin de la drogue, loin de cette violence crasse. »
Et, contre toute attente, c’est le personnage d’Emma Bovary du roman de Flaubert, découvert par hasard au collège qui va l’ancrer dans sa révolte et dans son désir de changer de vie. « J’aimais me plonger dans l’univers de cette femme nommée Emma, qui s’imaginait une vie romantique et brillante et qui ne se satisfaisait pas de la médiocrité de celle qui lui était imposée… À une échelle moindre, les mêmes sentiments me traversaient. Moi non plus, je n’étais pas content de ma situation, de mon cadre de vie et même du monde auquel j’appartenais. Moi aussi j’imaginais des moyens pour l’enjoliver. »
Pousser la porte du ghetto
Alors, Olivier, dit Djono, arrivera-t-il à enjoliver sa vie comme il le rêve ? À sortir enfin du ghetto en poussant cette porte, symbolisée par l’illustration de la couverture de son livre ? Une porte qu’une main, la sienne peut-être, tente d’ouvrir pour arriver à s’échapper. Je vous laisserai, bien sûr, le soin de le découvrir.
Mais avant de terminer cette chronique. Je tiens à vous rassurer : ce livre n’est pas du tout un récit larmoyant, enrobé de pessimisme. C’est au contraire, non pas une leçon, mais un témoignage d’espoir, de vitalité où la volonté de changer le cours des choses, en dépit des situations parfois dramatiques évoquées, est toujours présente.
En alternant les épisodes difficiles et les petits moment de bonheur, le meilleur et le pire, le narrateur-auteur, par son écriture enlevée, par les situations parfois rocambolesques qu’il décrit, nous entraîne sur un chemin où l’on ne s’ennuie jamais. Il nous fait prendre conscience que le malheur ne sort pas toujours vainqueur de la lutte pour la dignité humaine. En réalité, dans La porte du ghetto d’Olivier Pies, pour parodier le titre des souvenirs d’enfance de Maryse Condé, si on a finalement plus souvent le cœur à rire que le cœur à pleurer, on a surtout beaucoup de choses à méditer. Entre autres celle-ci où l’auteur évoque un séjour chez sa tante Francelyse à Dugazon, plus déshéritée encore que sa propre mère à Boissard :
« Nous avons vécu plus d’une année dans une indigence sans nom et pourtant ce fut la période la plus heureuse de mon enfance. Difficile à croire, n’est-ce pas ? Voilà une preuve concrète que ce n’est pas l’argent qui fait le bonheur. Il est parfaitement possible de se sentir heureux sans un sou en poche. Mais pour y arriver, il faut savoir remplacer le manque matériel par autre chose… »
Pour découvrir ce qu’est cette autre chose, je vous renvoie à ce petit ouvrage qui m’a personnellement à la fois enchanté et ému :
La porte du ghetto d’Olivier Pies.
Bonne lecture à tous.
PS. Olivier PIES, né en 1972, est licencié avec mention en chimie de l’Université
Antilles-Guyane et exerce actuellement comme professeur des écoles.
Publié par Raymond Joyeux
le samedi 13 janvier 2024
)



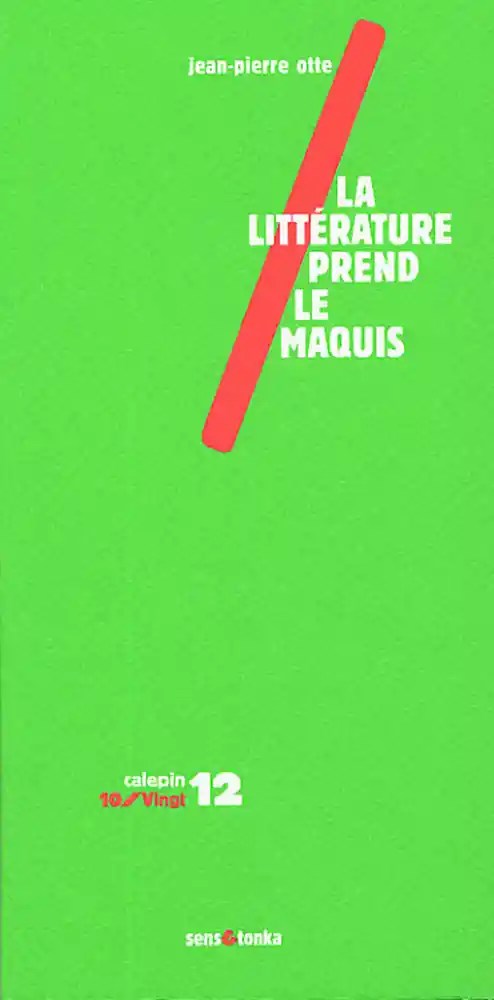
Bonjour Raymond, avez-vous l’intention d’échanger la casquette d’écrivain-poète contre celle de critique littéraire ? Cette dernière vous va aussi bien que la première !
Bonjour Liliane,
j’ai rencontré l’auteur à Cultura qui dédicaçait son ouvrage. Je suis toujours intéressé par les auteurs, curieux de connaître leurs productions. D’emblée ce petit livre m’a plu et ai vu tout de suite qu’il méritait une présentation. D’où cette chronique. Je vous remercie pour votre fidélité.
Bonjour,
Je salut le courage de Monsieur PIES, car parler de son enfance avec autant d’authenticité, est tous simplement incroyable, déchirante et si réel. Je pense aussi qu’il fallait un très grand courage pour avoir utilisé le vrai prénom de chaque personnage. « Chapeau bas », comme on dit chez nous.